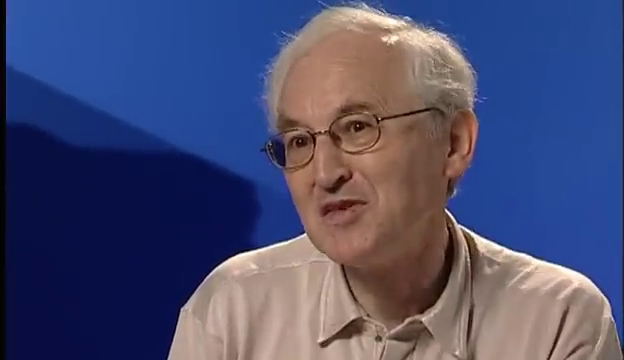
En 2008, Gilles L’Hôte réalisait deux entretiens filmés avec Jacques Bouveresse : Le besoin de croyance et le besoin de vérité et Les intellectuels et les médias (DVD, durée 240 mn, éd. À la source du savoir)1. Je propose ici une transcription (en trois parties) de l’entretien sur Les intellectuels et les médias, accompagnée de quelques notes pour préciser une référence de Jacques Bouveresse à texte (article, livre), à un événement ou un contexte.
Première partie ici
Deuxième partie ici
Jacques Bouveresse, Les intellectuels et les médias, 3ème partie
[Où il sera question de l’éthique journalistique, de l’importance de la classe de philosophie, des journalistes et des philosophes, de ce qu’est le journalisme trop souvent et de ce qu’il pourrait être, et de savoir, en pensant à Bourdieu, si on peut être savant et engagé en même temps]
TRANSCRIPTION – Les titres reprennent le chapitrage du film, seules les notes sont de moi ; j’ai conservé le style oral de l’entretien par respect de Jacques Bouveresse ; je me suis contenté d’introduire une ponctuation, de supprimer les répétitions, les hésitations et les bribes de phrases abandonnées par Jacques Bouveresse quand il préférait reformuler une idée.
Éthique journalistique
J’arrive encore moins à partager une forme d’optimisme qui est aussi très répandue et qui consiste à compter plus ou moins sur la bonne volonté des capitalistes pour que les inégalités sociales diminuent, ou à compter sur leur sens moral. Là on pourrait évoquer évidemment tout le problème de l’éthique, puisque on est littéralement assassiné tous les jours de considérations soi-disant éthiques, il y a une espèce de d’invasion de tous les secteurs de l’existence par un discours prétendument éthique.
Au début de l’an 2000, Chirac a dit — cela m’avait frappé aussi énormément — que le 21e siècle serait le siècle de l’éthique. Alors j’en ai conclu que ce serait un siècle où on parlerait effectivement beaucoup d’éthique mais, en général, vous savez, l’éthique c’est le genre de choses, plus on en parle moins on en a. C’est d’ailleurs en cela, sans y mettre une attention particulièrement malveillante, que l’on parle tellement d’éthique et de déontologie dans les milieux journalistiques. Chaque fois que j’entends cela — « faites-nous confiance, nous avons un sens moral très développé, nous ne faisons pas n’importe quoi, nous sommes des êtres responsable » — là je deviens inquiet. Je me dis qu’il vaudrait mieux de façon générale, dans les rapports entre les êtres humains, ne pas avoir quand même à compter exclusivement sur le sens moral des gens à qui on a affaire. On a envie d’avoir des garanties un peu plus solides que cela.
C’est un des aspects du problème que soulève la profession journalistique. Ce sont des gens qui sont convaincus d’avoir un sens moral beaucoup plus développé que les autres. Ce qui fait, qu’au fond, ils considèrent comme incongru d’essayer de leur demander des garanties que, d’après eux, ils n’ont pas à fournir. Mais cela, c’est un problème redoutable.

Regardez les fameux « phénomènes d’emballement » — c’est comme cela qu’on les appelle, ce qui s’est passé avec l’affaire d’Outreau2, avec l’affaire du bagagiste de Roissy3 ; ce qui s’était passé déjà au moment de l’assassinat du petit Grégory Villemin4. La presse a été capable d’écrire littéralement n’importe quoi. Et cela a des conséquences la plupart du temps : il y a des réputations qui se trouvent détruites, des existences humaines qui se trouvent anéanties (dans l’affaire du procès d’Outreau, c’est évident) ; imaginez la situation des gens qui sont obligés, après cela, d’essayer de de rebâtir leur vie. Et ici il se passe quoi ? Il y a quelques excuses hypocrites, vous allez avoir dans un journal comme Marianne ou un autre, je ne sais pas, des considérations attristées sur tous ces phénomènes d’emballement, et puis on a l’impression qu’ils sont tout prêts à recommencer exactement de la même façon la prochaine fois. Il ne se passe rien.
C’est un peu ce qui avait frappé Kraus au moment d’une affaire que j’ai évoquée à différentes reprises parce qu’elle est absolument exemplaire. En 1909, l’Autriche Hongrie a essayé de justifier le déclenchement d’une guerre préventive contre la Serbie (cela évoque, évidemment, ce qui s’est passé récemment entre les États-Unis et l’Irak) ; il y avait la volonté de faire la guerre, le seul problème était de trouver un prétexte susceptible de convaincre, d’abord la presse et ensuite l’opinion publique. Kraus pose la question dans un aphorisme de 1915 :
Comment le monde est-il gouverné et conduit à la guerre ? Les diplomates disent des mensonges aux journalistes puis ils les croient quand ils les voient imprimés5
Vous pouvez appliquer cela à la façon aux conditions dans lesquelles a été déclenchée la guerre en Irak. Ce qui s’est passé en deux mots : l’Autriche-Hongrie — voulant impliquer la Serbie dans un soi-disant complot fomenté par des députés croates qui étaient à la Diète de Croatie (contre l’Autriche) — a fabriqué des faux documents pour essayer d’impliquer les députés en question, pour en tirer ensuite une raison de déclencher une guerre préventive contre la Serbie. Malheureusement, les députés en question ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Il y a eu un procès. Kraus a assisté à la totalité du procès6. Cela se passait en 1909, donc 5 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce qui est rend l’affaire particulièrement exemplaire. Dans la Neue Freie Presse, le grand journal libéral, était en effet paru un article publié par un historien réputé qui s’appelait Friedjung (c’est pour cela que le procès porte le nom de « procès Friedjung »), article écrit sur la base de documents fournis très officiellement par le ministère des Affaires étrangères autrichien mais qui étaient des faux. Ce qui a été démontré sans trop de difficultés lors du procès. L’affaire a tourné alors à la confusion complète de l’Autriche, et d’abord de Friedjung, l’historien — là, vous voyez, il y a un intellectuel qui s’était laissé impliquer dans l’affaire, ce qui est aussi très révélateur parce que malheureusement, dans ces circonstances-là, il est rare que les intellectuels arrivent à résister tout à fait aux pressions exercées par le pouvoir politique. Et donc l’affaire s’est terminée de façon lamentable pour l’historien Friedjung, pour le ministère des Affaires étrangères et pour l’Autriche.
La similitude, avec la façon dont les conditions dans lesquelles a été déclenchée la guerre en Irak, est tellement extraordinaire que je me suis permis dans un article qui paraîtra bientôt7, d’insister un peu sur le parallélisme parce que, là aussi, la presse aux États-Unis, s’est laissé piéger complètement et entrainer dans ce qui était une pure une affaire de propagande, destinée à justifier une guerre préventive qui n’avait pas lieu d’être. Et là il s’agit de la meilleure presse. Ce n’est pas la presse de presse de bas étage, la presse de caniveau, la presse nationaliste, celle qui fait preuve d’un nationalisme imbécile comme peut le faire par exemple la presse de caniveau anglaise, le Sun ou des journaux de cette sorte, c’est la presse du plus haut niveau. Et une fois que ce genre de chose a été fait, qu’est ce qui se passe ? Quelques semaines ou quelques mois après, on reconnait que l’on s’est laisser intoxiquer, que l’on a imprimé des choses inexactes — puisque là aussi on peut dire le gouvernement américain a fourni des fausses preuves, qui n’ont pas été reconnues comme telles.
Ce sont deux situations tout à fait semblables, et ce qui est semblable également, c’est la constatation attristée que fait Kraus. Il relève que dans un premier temps, à propos de l’affaire Friedjung, le public dit « oh là là ! il y a eu un complot fomenté contre l’Autriche par des députés croates, ben ça alors » ; puis dans un deuxième temps, il dit « Ah ! ben non finalement, il n’y avait pas eu de conspiration contre l’Autriche » ; le public des lecteurs de journaux fait un nouveau « ben ça alors », puis il ne tire aucune conséquence, il ne se passe rien, en tout cas pour ce qui concerne la réputation des journaux qui reste sensiblement la même. Enfin les gens un peu méfiants se disent que dans des conditions identiques, les choses très probablement recommenceront exactement de la même façon. Donc là il y a un problème.
Chaque année il y a des enquêtes qui sont faites pour déterminer la cote de confiance dont bénéficient la presse. Il est quand même frappant de constater que moins d’une personne sur deux font confiance aux journaux pour ce qui est de l’aptitude à dire la vérité, à raconter des choses exactement comme elles se sont passées. Ce qui est quand même préoccupant, si vous voulez. Je suis un peu étonné quand même que la presse ne s’inquiète pas davantage du fait qu’elle inspire aussi peu confiance ; je dis en principe, parce que — encore — entre ce que les gens disent et la façon dont ils réagissent quand ils lisent les journaux…
[Ce propos de Bouveresse n’est pas démenti par la dernière enquête de 2023 : près de six Français sur dix (57%) considèrent qu’il faut “se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité” selon la 37e édition du baromètre La Croix/Kantar Public ; 59% des personnes interrogées considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants “aux pressions des partis politiques et du pouvoir” ; 56% pensent qu’ils ne résistent pas “aux pressions de l’argent”.8]
Kraus dit que le lecteur est plus impressionné par ce qu’il voit imprimé qu’il ne pourrait l’être par ce que les sept sages de la Grèce pourraient lui murmurer à l’oreille9, ce qui est quand même assez vrai. Autrement dit, d’un côté sur les gens, officiellement, affichent la plus grande méfiance à l’égard de ce que peuvent écrire les journaux, mais en même temps ils peuvent les croire beaucoup plus qu’ils ne qu’ils ne sont prêts à le reconnaitre, il est évident qu’il y a les deux choses, le prestige de la chose imprimée est évidemment considérable.
La classe de philosophie spécialité française
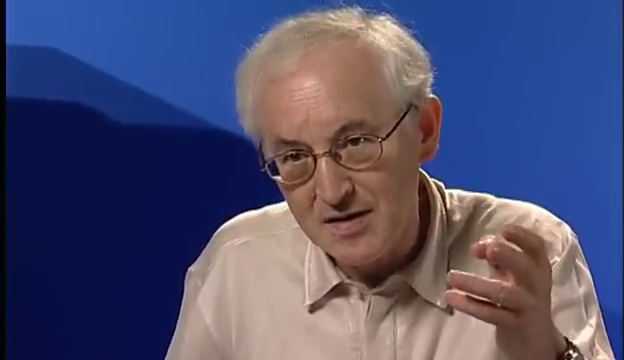
C’est Musil, je crois, qui fait cette constatation sur le fait qu’il y a une forme d’importance (c’est le cas de l’importance qu’ont les journalistes) et qui provient essentiellement de la fréquentation de gens réellement importants, ce qu’on peut appeler ce côté parasitaire que joue le journalisme et qui a été dénoncé en particulier par Kraus.
Le journaliste n’est pas réellement important en soi mais il a un rapport privilégié avec les choses importantes, en particulier des choses importantes du monde intellectuel, au nombre desquels figurent, et en occupant même une place imminente, tout ce qui est philosophique ; surtout en tout cas dans un pays comme la France, car c’est un peu moins vrai dans d’autres pays, beaucoup moins vrai dans les pays anglo-saxons par exemple, où les philosophes sont plus facilement considérés comme étant eux-mêmes des techniciens d’une certaine sorte, en raison du genre de philosophie qui s’est développée (ce qu’on appelle la philosophie analytique) qui est une philosophie quand même sensiblement plus technique que la philosophie telle qu’on la comprend en France qui est en général beaucoup plus littéraire.
Dans les pays anglo-saxons, l’Angleterre et surtout les États-Unis, on a l’impression que la philosophie est considérée comme une spécialité plus ou moins technique qui n’a pas de de rapport privilégié avec les questions d’intérêt général ou, en tout cas, pas beaucoup. Les philosophes (en tout cas ceux que je connais et j’apprécie) ne sont pas gens que l’on aura beaucoup de chance de voir à la télévision pour donner leur opinion sur des questions d’intérêt général.
La France est dans une situation tout à fait particulière, notamment en raison de de l’existence de la classe de philosophie, qui est une chose qui n’existe presque nulle part ailleurs. Il n’y a pas beaucoup de pays où tous les élèves des terminales de lycée bénéficient de cet enseignement, qui est supposé être un élément essentiel de la formation du citoyen. Évidemment la théorie qui est officiellement défendue par les professeurs de philosophie est que ce qu’ils font est absolument indispensable à la formation, en particulier de la conscience politique. Et ils pensent, en général, que c’est parce que les citoyens, ou en tout cas la plus grande partie des gens, sont passés en France par ce genre de formation que l’on a une conscience politique beaucoup plus aiguisée qu’ailleurs. Ce qui est, jusqu’à un certain point, vrai.
Il est vrai que la France est un pays où probablement on a une conscience politique un peu plus développée que dans beaucoup d’autres pays et en tout cas qu’aux États-Unis. C’est tout à fait certain, on discute beaucoup plus de politique qu’ailleurs et je me rappelle je ne sais plus qui disait (je ne sais pas si ce n’est pas Jankélévitch) que le goût pour la philosophie était un peu dans le prolongement du goût pour la conversation de café. Il y a des choses dont en France on parle énormément, en particulier les questions politiques et on est supposé avoir été éduqué à cela, ou en tout cas c’est une tendance qui est supposée avoir été renforcée et en même temps affinée par la pratique de la philosophie et par la classe de philosophie.
Mais pour ce qui est du problème précis que vous souleviez, je crois qu’il y a deux tendances qui sont presque contradictoires et auxquelles on cède presque simultanément en ce qui concerne la philosophie.
Il y a, d’un côté, une conception assez traditionnelle qui consiste à dire que la philosophie doit nous faire accéder aux vérités les plus importantes, aux vérités les plus fondamentales, en particulier les vérités de l’espèce qu’on appelle métaphysique, celles qui sont à la base de toutes les autres. La philosophie est supposée nous faire découvrir ce genre de vérités auxquelles est la seule à avoir accès et à pouvoir nous ménager un accès.
Puis, en même temps, il y a une certaine tendance au contraire à plutôt rattacher la philosophie à ce que l’on pourrait appeler la mentalité socratique : la tâche de la philosophie consiste essentiellement à nous apprendre à douter de tout ce dont nous pouvions nous imaginer le savoir. Ce qui fait qu’à la limite la philosophie est considérée comme le contraire d’un savoir, le contraire d’une entreprise qui aurait pour but de nous de nous communiquer un savoir d’une certaine sorte.
La plupart du temps, ces deux choses sont simultanément vraies. À l’intérieur de tout philosophe, je crois qu’il y a qu’il y a plus ou moins ces deux façons de concevoir l’entreprise philosophique : une façon qui consiste à la concevoir comme orientée vers la recherche de vérité d’un type spécial et d’une espèce particulièrement importante, et une autre qui consiste à la concevoir plutôt comme étant une entreprise essentiellement critique, ayant pour fonction de susciter des inquiétudes et des doutes partout où quelque chose comme une vérité, en tout cas une vérité définitive, pourrait donner l’impression d’avoir été découverte.
Les philosophes et les médias
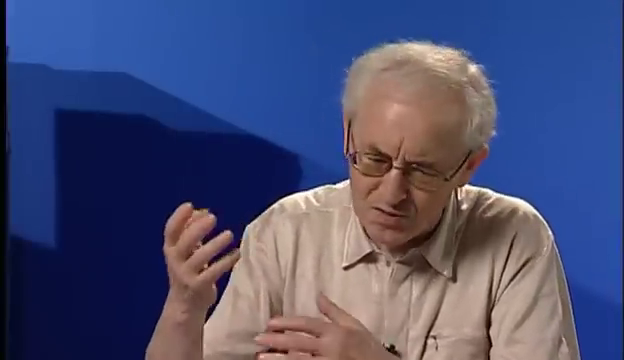
Il y a en France, y compris dans les médias, une espèce de vénération particulière pour la philosophie, une conviction largement partagée que les philosophes, d’une certaine façon, détiennent plus ou moins le dernier mot sur tous les types de questions, et qu’on en reste à une perception et une description plus ou moins superficielle aussi longtemps que l’on n’a pas accédé au stade de la réflexion philosophique proprement dite.
Ce qui explique évidemment le prestige spécial dont ont bénéficié les philosophes qui sont des gens qui occupent des positions extrêmement importantes dans les médias où ils sont beaucoup appréciés. Parmi les philosophes qui actuellement occupent le devant de la scène, on peut remarquer qu’ils sont très appréciés du pouvoir politique, très appréciés du pouvoir médiatique (cela va sans dire puisqu’on les voit assez régulièrement à la télévision), et aussi du pouvoir économique.
Donc le pouvoir politique, le pouvoir médiatique et le pouvoir économique, se les disputent d’une certaine façon. Certains d’entre eux sont font partie des conseils d’administration de certaines entreprises ; ils ont en effet une rhétorique qui est très au point — étant passé moi-même par le système, je suis particulièrement bien placé pour savoir avec quelle efficacité ils sont formés et à quel point leur rhétorique est excellente et convaincante, une rhétorique qui fait beaucoup d’effet sur le milieu patronal. Certains d’entre eux sont, paraît-il, extrêmement recherchés, ils font des conférences, etc.
Le plus important est la conséquence : cette demande philosophique10 renouvelée a semble-t-il engendré l’impression d’un renouveau de la philosophie. On entend dire depuis quelques temps un peu partout qu’il y a un renouveau de la philosophie extrêmement important et que jamais la discipline ne s’est aussi bien portée. Ce qui, je dois dire, m’amuse beaucoup parce que ce n’est évidemment pas parce que vous avez 3 ou 4 philosophes, ou un peu plus, qui écrivent des best-sellers, des ouvrages de philosophie qui se vendent 200.000 exemplaires, - quelques philosophes qui obtiennent des succès de ce genre, qui se produisent régulièrement à la télévision, qui siègent dans les conseils d’administration de certaines entreprises ou même qui siègent au Comité National d’Éthique, que l’on peut conclure de là à un renouveau caractéristique et incontestable de la philosophie. Pour apprécier le bon état de la philosophie, la bonne santé de la discipline, il faut utiliser évidemment d’autres critères et il faudrait consentir aussi à regarder un peu le travail obscur que font tous les gens qui écrivent des livres qui sont véritablement des livres qui comptent, mais qui se vendent péniblement à quelques centaines d’exemplaires. C’est un autre aspect du problème.
J’ai parlé de l’injustice et de l’arbitraire avec lesquels s’exerce le pouvoir des médias dans ce domaine, et là c’est très frappant. Quand on est dans le métier depuis un bon moment, ce qui est mon cas, on a l’impression qu’ils n’aident presque pratiquement pas les livres qui auraient le plus besoin d’être défendus, ceux qui mériteraient le plus de l’aide, parce que justement s’ils ne sont pas soutenus, de façon quelconque, l’importance objective qu’ils ont ne sera pas reconnue. Bourdieu avait cette formule : ils passent « le plus clair de [leur] temps à consacrer des gens déjà consacrés »11.
On pourrait dire aussi qu’ils viennent toujours au secours du succès. Ce qui a déjà du succès ou ce qui de toute façon en aurait, c’est cela qui les intéresse. Ils n’ont pas tellement envie de faire un travail d’exploration qui est très ingrat, très difficile à faire, pour aller voir ce qui se fait réellement. Ils ne parlent que d’une toute petite partie de ce qui se fait en philosophie. Je suppose que c’est pareil dans d’autres domaines - le cas de la littérature n’est sans doute pas très différent.
C’est très pénible à observer surtout lorsque pour votre part vous êtes en permanence justement avec la partie qu’ils ignorent, ce qui est mon cas : depuis les années 60 je ne me suis intéressé pratiquement qu’à des choses qu’ils ont ignorées. Évidemment, avec le temps, les choses changent. Par exemple, je me suis énormément intéressé en philosophie à Wittgenstein - je l’ai fait depuis le milieu des années 60. Bon, à l’époque, inutile de vous dire que cela n’intéressait pas du tout la presse, les médias en général, aujourd’hui c’est sensiblement différent. C’est ce qui se passe à nouveau actuellement : je m’intéresse à peu près systématiquement à ce qui ne les intéresse pas eux.
Je dois dire que j’ai même presque une sorte de perversité – bon, je n’ai pas forcément raison - j’avoue que les choses qui sont à la mode m’intéressent en général très peu, et j’ai plutôt tendance à aller voir s’il n’y a pas quelque chose d’au moins aussi intéressant, sinon plus intéressant, qui au même moment est complètement laissé de côté. Mais en tout cas c’est assez pénible quand vous voyez l’étendue et l’importance de ce qu’ils ignorent, de ce dont ils n’ont même probablement aucune idée, parce que pour en avoir une idée il faudrait avoir une curiosité réelle et même une curiosité presque illimitée. Or, si on regarde les choses d’un point de vue un peu un peu naïf, on se dit que c’est cela qu’ils devraient faire ; ils devraient passer leur temps à essayer de regarder dans tous les coins pour voir s’il n’y a pas quelque chose que leurs confrères ont oublié et qui est en train de se passer. Ce n’est pas du tout ce qu’ils font la plupart du temps : ils font à peu près tous la même chose, ils parlent à peu près tous des mêmes livres, et à peu près dans les mêmes termes. Donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu désolant. C’est même plus que désolant.
Cela fait penser deux formules de Musil que je cite souvent.
Musil dit que ce qui est douloureux dans le cas du journalisme, c’est le contraste entre ce qu’il est et ce qu’il pourrait être. Autrement dit, je ne suis pas en train du tout de parler comme quelqu’un qui pourrait souhaiter de près ou de loin la disparition de la presse ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui s’imaginent que c’est ce que Kraus lui-même voulait, je ne le crois pas. D’abord Kraus n’est pas assez naïf pour penser que c’était possible, et ensuite, je ne pense pas non plus qu’il considérait cela comme souhaitable.
Mais je pense comme Musil que ce qui est douloureux, c’est vraiment le contraste qu’il y a entre ce qu’ils pourraient faire, par exemple pour la philosophie, et ce qu’ils font réellement - pour s’en tenir à un aspect du problème qui n’est pas très important, qui est même probablement secondaire. Mais c’est vrai aussi de façon générale : on a le sentiment qu’il devrait être possible de faire infiniment mieux, en tout cas de faire beaucoup mieux, et que cela ne serait même probablement pas tellement difficile.
L’autre formule de Musil que j’aime beaucoup est dans L’homme sans qualité. Il dit ceci :
Pour on ne sait quelle impondérable raison, les journaux ne sont pas ce qu’ils pourraient être, à la satisfaction générale, les laboratoires et les stations d’essai de l’esprit, mais des bourses et des magasins.12
Il y a d’ailleurs dans l’Homme sans qualité un personnage de journaliste, Meseritscher13, qui est tout à fait extraordinaire. Là, Musil met le doigt sur une chose qui nous frappe de plus en plus. On s’attendrait à ce que les journaux participent de façon active et intelligente à la vie de l’esprit — Musil dit qu’ils pourraient être « les laboratoires et les stations d’essai de l’esprit » — puis en réalité, ils donnent l’impression d’être quoi ? « ses bourses et des magasins »14, c’est-à-dire des agences de publicité, de promotion, etc.
Il y a cette rubrique absolument effarante dans le Nouvel Observateur, la rubrique « en hausse, en baisse », on l’impression que, au fond, le problème c’est de suivre les cotations à la bourse des valeurs. D’un côté, on vous dit que les productions intellectuelles ne sont pas du tout des productions comme les autres, qu’elles ne devraient pas relever de la loi du marché, et en même temps on vous inflige cette chose absolument innommable, « les personnalités en hausse », « les personnalités en baisse », et qui sont souvent des personnalités d’intellectuels. Ce qui veut dire qu’au fond on accepte tout à fait, dans les faits, de se livrer à ce jeu de la bourse des valeurs.
On parlait tout à l’heure du degré auquel la loi du marché, les mécanismes du marché, ont été acceptés et ont même été intégrés au mode de pensée chez les intellectuels eux-mêmes. Et cela c’est une un indice qui ne trompe pas.
Le porteur de nouvelles n’est plus à la bonne place
À propos du rôle que joue aujourd’hui le journaliste, il y a quelque chose qui peut prêter à confusion dans ce que dit Kraus. J’ai dit qu’il ne souhaitait pas du tout le la disparition de la presse et pas non plus, bien sûr, la mort des journalistes. Mais il pense qu’il y a eu une espèce d’usurpation de rôle et de fonction qui s’est produite à un moment donné. Il a le sentiment que le journaliste qui aurait dû occuper une fonction certes honorable — mais subalterne, c’est-à-dire celle du porteur de nouvelles, d’informateur, de celui qui vous communique des informations, et que tout d’un coup le journaliste avait voulu occuper, et jusqu’à un certain point réussi à occuper, un rôle beaucoup plus important, celui de défenseur de de la vérité, de la culture.
Il y a un passage très remarquable où il dit - c’est le sentiment qu’il a - que celui qui aurait dû rester en serviteur respecté - parce qu’on peut après tout avoir du respect pour les gens qui occupent ce genre de position, s’est transformé en un maitre abusif qui du même coup est méprisé et haï. Ce qui explique en partie sur les attitudes qu’a souvent le milieu intellectuel à l’égard de la presse.
Cyril Lemieux a écrit un livre intitulé Mauvaise presse, paru il y a un certain nombre d’années. « Mauvaise presse » renvoie à l’idée que la presse a plutôt de façon générale « mauvaise presse », c’est-à-dire au fait que les gens expliquent qu’ils ne lui font pas tellement confiance. Au fond l’impression de Kraus est que c’était à peu près inévitable lorsque le serviteur sort de la fonction qu’il devrait se contenter d’exercer et qui pourrait lui permettre d’être traité avec égard.
Lorsqu’il sort de cette fonction pour usurper un rôle qui n’est pas le sien, il s’expose évidemment à être craint — j’avais une fois caractérisé cette situation à l’aide du slogan « Qu’ils méprisent, pourvu qu’ils lisent ! ». La presse a souvent le sentiment d’être quelque peu mal perçue et même plus ou moins méprisé, mais en même temps, elle se dit qu’au fond ce n’est pas très important, parce que le mépris on peut le supporter, on peut vivre avec, on peut même vivre plus ou moins de cela.
C’est pour cela que dans le livre que j’ai écrit sur Kraus, j’avais utilisé cette formule qui me plaisait assez : « Qu’ils méprisent, pourvu qu’ils lisent ! »15. Pour en revenir à ce dont je voulais parler, Kraus dit :
Nous avons mis l’homme qui doit annoncer l’incendie et qui devrait sans doute jouer le rôle le plus subalterne dans l’État au-dessus du monde, au-dessus du feu et au-dessus de la maison, au-dessus du fait et au-dessus de notre imagination.16
Cela résume tout à fait cette espèce d’usurpation de rôle, de fonction, de dignité, qu’il reproche aux journalistes.
Raisons d’agir : la réforme de la volonté
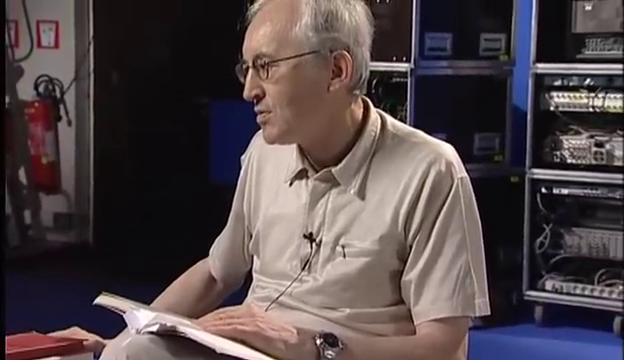
Il y a deux façons de se représenter la fonction et le rôle de d’intellectuel.
Celle qui consiste à dire que l’intellectuel doit se borner à être le serviteur désintéressé de la vérité, quelle que soit la nature de celle-ci, qu’elle fasse plaisir aux gens ou non, qu’elle permette ou non d’agir du point de vue politique et social. Il est arrivé à un certain moment que l’on reproche aux intellectuels d’avoir plus ou moins trahi cette obligation d’être les serviteurs désintéressés de la vérité, à l’exclusion de tout autre chose. Julien Benda est l’auteur d’un livre célèbre, La trahison des clercs, dans lequel il reproche aux intellectuels d’avoir pris position au moment de la guerre de 14 (et c’est d’ailleurs aussi l’un des reproches majeurs que Kraus adresse non pas seulement aux journalistes mais également aux intellectuels), et de s’être engagés de façon partisane à un moment où il aurait fallu, au contraire, essayer de rester les serviteurs désintéressés de la vérité et de la justice. Par conséquent, il peut y avoir cette tendance à dire que, par définition, un intellectuel ne doit pas s’engager, il ne doit s’engager qu’au service de la vérité, indépendamment de toute l’idée d’application, en particulier d’application de nature politique.
Mais, comme vous savez, on est passé par une phase — Sartre est un exemple typique de cela — où au contraire l’idée qu’on avait était plutôt qu’un intellectuel, par essence en quelque sorte, devait être engagé ; que les intellectuels qui n’étaient pas engagés, l’étaient en réalité encore d’une certaine façon en vertu du principe bien connu : si vous croyez pouvoir vous tenir à l’écart de la politique de toute idée, de toute espèce d’engagement politique, c’est encore une façon de faire de la politique, et probablement une des pires façons de le faire — c’est-à-dire sans l’avouer ouvertement, sans avoir une claire conscience de que vous êtes en train de faire.
Il y a donc ces deux tendances en ce qui concerne l’intellectuel. Le cas de Bourdieu est particulièrement significatif parce que je crois qu’il a réussi à être à la fois un savant et un politique — c’est le thème du petit livre que je lui ai consacré qui s’intitule Bourdieu, savant et politique17. Il a réussi à agir à la fois sur le terrain de la science ; il s’est montré particulièrement intransigeant sur ce terrain parce que, contrairement à ce que lui ont reproché un certain nombre de ses adversaires mal inspirés sur ce point, sur terrain-là il n’a jamais fait la moindre concession, il a toujours plaidé en faveur du respect le plus strict des exigences de la méthodologie scientifique. Il a donc réussi à être à la fois un savant et un politique, quelqu’un qui agit sur le terrain de la lutte sociale et politique. Avec cette particularité qu’il ne s’est pas simplement engagé politiquement : il a essayé de tirer de son travail théorique, celui qu’il a réalisé dans les sciences sociales, d’en tirer des implications et des conséquences politiques.
Bourdieu était convaincu —et c’est un point sur lequel nous avons eu beaucoup de discussions, parce que j’étais, je l’avoue, un peu plus sceptique que lui — que le savoir, le meilleur savoir en tout cas, a des conséquences, c’est-à-dire que quand on sait mieux, on agit autrement.
Vous avez raison de remarquer qu’il est tout à fait dans le rôle de l’intellectuel spécifique, qui est presque exactement le contraire de l’intellectuel philosophe, qui est presque toujours un intellectuel général. Un des points de désaccord fondamentaux de Bourdieu avec la philosophie consistait précisément dans le fait qu’ils reprochaient aux philosophes d’être toujours intellectuels universels, habitués à raisonner en termes précisément universels et victime de ce qu’il appelait « l’illusion scolastique » dans Les méditations pascaliennes où il développe longtemps ce thème, c’est-à-dire le fait que les philosophes occupent la position de l’homme de « loisir », qui est plus ou moins libéré des contraintes de l’action, et qui du coup reste à une distance beaucoup trop grande des réalités, en particulier des réalités sociales, ce qui le rend incapable de se rendre compte qu’un certain nombre de choses qu’il dit sont en réalité précisément le reflet de cette position privilégiée, de cette position d’exception qu’il occupe. Et lui, au contraire, était convaincu que le genre de science qu’il essayait de de développer lui permettait d’agir réellement, et de le faire de façon à la fois beaucoup plus informée et beaucoup plus efficace. Il était persuadé que la connaissance acquise grâce aux sciences sociales devait être en mesure de produire des effets sociaux.
C’est l’un des points sur lesquels on a très souvent discuté parce que j’étais un peu plus réticent que lui. Je pense que savoir mieux est une condition nécessaire, mais je doute que ce soit une condition suffisante, il me semble qu’il faut quelque chose de plus que cela. C’est un point qu’il a fini par considérer comme très important ; il en a souvent reparlé dans les dernières années et il citait de temps Wittgenstein qui dit (à propos d’autre chose) que la réforme qu’il faut produire n’est pas seulement, et même peut-être pas d’abord, une réforme de l’intellect, mais une réforme de la volonté. Et cela m’a paru s’appliquer tout à fait à la situation dans laquelle il se trouvait.
On peut arriver à en savoir beaucoup plus sur la réalité sociale, on peut en particulier réussir grâce aux instruments qui sont fournis par la science sociologique à mettre au jour les mécanismes qui gouvernent le fonctionnement des sociétés, qui engendrent des formes de méconnaissances diverses, c’est-à-dire les mécanismes qui font que les gens agissent de la façon dont ils le font et en même temps sont dans l’ignorance des raisons pour lesquelles ils le font. Mais pour passer de cela à la modification des comportements, il semble qu’il faille encore quelque chose de plus, quelque chose qui semble être davantage de l’ordre de la volonté que de l’intellect.
Cela me semble être une des difficultés majeures et, naturellement, comme je n’ai pas de réponse à cette question, quand j’ai critiqué Bourdieu, je l’ai toujours fait avec beaucoup de prudence, parce que je crois que, lui et moi, nous étions un peu à la recherche de la même chose : comment arrive-t-on à produire cette réforme de la volonté qui semble nécessaire en plus de l’information acquise au niveau de l’intellect ?
Notes
-
On les trouve sur Internet : Les intellectuels et les médias et Le besoin de croyance et le besoin de vérité. ↩︎
-
L’affaire d’Outreau concerne des faits d’agression sexuelle sur mineurs ayant eu lieu entre 1997 et 2000, douze enfants reconnus en première instance victimes de viols (avec à l’arrivée leurs 4 auteurs condamnés). Mais c’est aussi l’histoire d’un naufrage judiciaire qui débouche sur l’acquittement de treize présumés coupables, dont plusieurs avaient été maintenus en prison pendant plusieurs années, alors qu’ils étaient innocents, comme la montré tardivement l’instruction. Et une quatorzième victime, François Mourmand, mort en prison de « surcharge médicamenteuse » avant d’être jugé. L’erreur judiciaire a bien entendu fait les gros titres sur échec cuisant de la justice, et avec un empressement aussi important, sinon plus, que celui qu’elle avait manifesté quand elle jetait en pâture les monstres suspectés du pire. Pour illustrer ces dérapages de la presse sérieuse, respectueuse de l’éthique et qui vérifie tours les faits, Bouveresse aurait pu citer le cas l’affaire Baudis/Allègre où Le Monde (parmi tant d’autres) s’est particulièrement illustré en publiant une série d’articles sur une prétendue « affaire », mêlant un vrai tueur en série, Patrice Alègre, de vraies prostituées… et l’ancien journaliste et maire de Toulouse (mais de droite), Dominique Baudis, accusé de viol et d’actes de barbarie. Dans son édition du 17 juin 2003, Le Monde détaillait même « les faits » : « Derrière les tentures qu’ils ont arrachées, les gendarmes ont découvert dans les murs plusieurs fixations d’anneaux qui avaient été meulés. Ces anneaux étaient situés bas, à une cinquantaine de centimètres du sol, à hauteur d’enfant ou d’une personne devant se tenir accroupie ou à quatre pattes. » Le lendemain, le procureur de Toulouse démentait « formellement les prétendues constatations du Monde ». Les journalistes n’avaient même pas visité l’endroit ! L’affaire Baudis, entièrement inventée, s’est terminée par un non-lieu général. Ce qui n’a pas empêché le journaliste du Monde, qui affirmait détenir des « éléments matériels » incriminant Baudis, d’expliquer déontologiquement qu’il « n’y aurait pas eu de doute si, dès le début, le procureur de la République, qui est chargé d’informer l’opinion de l’avancée de l’enquête, avait eu des rencontres régulières avec la presse ». Bref, si les journaux racontent n’importe quoi et ne vérifient rien, c’est la faute de la justice qui n’informe pas en temps réel les journalistes des détails d’une instruction en cours. On peut donc aussi craindre le genre de justice qui ferait le bonheur des journalistes. ↩︎
-
Le 28 décembre 2002, Abderazak Besseghir, vingt-sept ans, résidant à Bondy (Seine-Saint-Denis), travaillant à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, est interpellé sur le parking de l’aéroport avec des armes et des explosifs dans sa voiture. Il a été dénoncé par « un légionnaire à la retraite ». Des perquisitions sont menées et plusieurs documents « pouvant être de caractère islamiste » sont saisis. Lui évoque immédiatement l’hypothèse d’une vengeance familiale à la suite d’uu décès de sa femme. Pour tout la presse, l’affaire est entendue, les preuves sont accablantes. La section antiterroriste du parquet de Paris ouvre une information judiciaire, le bagagiste est mis en examen notamment pour " association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" et placé en détention provisoire. Les premières analyses des empreintes digitales relevées sur les armes et les explosifs retrouvés dans le coffre indiquent pourtant que ce ne sont pas celles du bagagiste. Elle se dégonflera ensuite, c’est bien sa belle-famille qui monté le complot. La chaîne France 3 est condamnée le 4 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir accusé Besseghir d’être un terroriste islamiste. ↩︎
-
L’affaire Grégory Villemin est une affaire criminelle, encore irrésolue, concernant un enfant de quatre ans, retrouvé noyé dans la Vologne, tête et mains liés. Une large partie de la presse en fera un feuilleton à sensation, n’hésitant pas à violer la vie privée de certaines parties, à raconter une nouvelle fois n’importe quoi, jetant en pâture le nom et la photo de présumés coupables à leurs yeux, etc., et tous différents selon le parti pris du journaliste. L’affaire aboutira non seulement à ruiner de nombreuses vie, mais au meurtre d’un des coupables désignés, et au suicide du juge Lambert (responsable de l’instruction catastrophique du dossier à ses débuts)… en 2017, après un ultime (faux) rebondissement, de nouveau très médiatisé. Sur l’affaire, voir la page Wikipédia (Affaire Grégory). ↩︎
-
Karl Kraus, Die Fackel, 5 octobre 1915, cité dans Thierry Discepolo et Jean-Jacques Rosat (coord.), « Les Guerres de Karl Kraus » [numéro disponible en ligne], revue Agone, n° 35-36, 2006, page 25. Voir aussi, BOUVERESSE, Jacques. Langage et illusion, dans Études de philosophie du langage, Collège de France, 2013. Disponible sur Internet : http://books.openedition.org/cdf/1980. ↩︎
-
Kraus fait l’analyse politique de cette affaire dans « Le procès Friedjung » (Karl Kraus, « Prozess Friedjung », Die Fackel, fin décembre 1909, n° 293, p. 1-20.), traduit par Pierre Deshusses « Les Guerres de Karl Kraus » (cf. références note précédente), pages 227-241, dans ce même numéro d’Agone, aux pages 36-37, voir ce qu’en dit Edward Timms dans son article « Karl Kraus et la construction de la réalité virtuelle ». Enfin, de Jacques Bouveresse sur Kraus et cette affaire, voir Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus Seuil, 2001, pages 78-80 et « “Au commencement était la presse…” » dans _Agone _n° 40, 2008, pages 214-215. Numéro disponible sur le site de l’éditeur. ↩︎
-
Cf. J. Bouversse, « “Au commencement était la presse…” Le pouvoir des médias & la rébellion de Karl Kraus : une leçon de résistance pour notre temps ? », Agone, n°40, 2008. ↩︎
-
Résumé par l’article de France-bleu de l’enquête réalisée 6 au 11 octobre 2023 pour le baromètre annuel La Croix-Kantar. C’est d’ailleurs bien le seul article de la presse « main stream » qui commence par ce qui, selon Bouveresse, devrait tout de même inquiéter sérieusement les médias, la défiance de plus en plus marquée du public et qui s’accroit année après année (ici +3 points par rapport à 2022). Les éditoriaux ou articles sur le sujet (presse écrite, radio et TV) préfèrent insister sur le fait que 75 % des sondés déclarent suivre « l’actualité avec grand intérêt », pour s’en féliciter, bien qu’ils n’y soient pas forcément pour quelque chose, et y voient un encouragement pour eux- mêmes, dont ils ne manquent pas de remercier leur public (lecteurs, auditeurs, téléspectateurs). Les éditorialistes ne paraissent aucunement remarquer que 75 % des sondés manifestent encore un « grand intérêt » pour « l’actualité », même si dans le même temps 57% jugent que la presse non fiable déclarant qu’il faut se méfier de ce que racontent les journalistes sur « les grands sujets d’actualité ». ↩︎
-
Cf. la citation complète dans Jacques Bouveresse, Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus Seuil, 2001, p. 70 : « Si nous nous demandons à présent sur quoi repose au juste la force de suggestion de la presse, on donnerait la réponse en disant que, comme aucune autre machine, il est de son essence de faire apparaître l’âne qui est à son service comme un dieu, et dans une mesure telle qu’il succombe lui-même à l’illusion. Une sottise imprimée en impose plus au lecteur que ce que les sept Sages de la Grèce pourraient lui murmurer à l’oreille. » ↩︎
-
Sur ce point, cf. Jacques Bouveresse, La demande philosophique : que peut la philosophie et que peut-on vouloir d’elle ?, éd. L’Éclat, 1996 [réédition en 2015], qui est la version longue de la leçon inaugurale prononcée par Jacques Bouveresse au Collège de France en octobre 1995. ↩︎
-
Cité aussi par Jacques Bouveresse dans une Conférence reprise et publiée sur le site des éditions Agone), Persistance de Pierre Bourdieu (III). Les médias, les intellectuels et le sociologue (3) et rééditée sous le titre « Le journalisme avant & après Bourdieu » dans Bourdieu, savant et politique, Agone, 2004. ↩︎
-
Robert Musil, L’Homme sans qualités, traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet, Seuil [1956, rééd. 1979], t. 1, § 77, p. 388. Le paragraphe (pages 388-392) s’intitule Arnheim en ami des journalistes. Cf. aussi Jacques Bouveresse, Le philosophe et le réel. Entretiens avec Jean- Jacques Rosat, Hachette Littératures, coll. Philosophie, 1978, page 25 pour la même citation et pages 25-28 pour la question du journalisme ; cf. aussi Jacques Bouveresse, « Robert Musil, la tâche de la littérature et la fonction sociale de l’écrivain » dans L’écrivain, le savant et le philosophe : La littérature entre philosophie et sciences sociales Éditions de la Sorbonne, 2003. Après la citation, Bouveresse commente ainsi « Musil constate que les journaux sont avant tout des auxiliaires indispensables dans le système du marché en général et du marché de la culture en particulier, mais qu’ils ne peuvent remplir cette dernière fonction qu’à la condition de réussir en même temps à se faire passer pour les serviteurs dévoués de la culture elle-même ». ↩︎
-
Sur le personnage, cf. Jacques Bouveresse, Robert Musil, la tâche de la littérature et la fonction sociale de l’écrivain » (dans l’ouvrage cité dans la note précédente). ↩︎
-
Ibid. ↩︎
-
Jacques Bouveresse, Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus Seuil, 2001, p. 36 : « Si la réputation de la presse est aussi mauvaise qu’on le dit, c’est une situation dont elle peut très bien s’accommoder en appliquant simplement le principe : « Qu’ils méprisent, pourvu qu’ils lisent ! » — sans parler d’un autre principe cynique qui peut avoir aussi son mot à dire dans cette affaire : « Qu’ils haïssent, pourvu qu’ils craignent ! » ↩︎
-
Ibid., p. 69. ↩︎
-
Jacques Bouveresse, Bourdieu, savant & politique, Éd. Agone, 2004. ↩︎